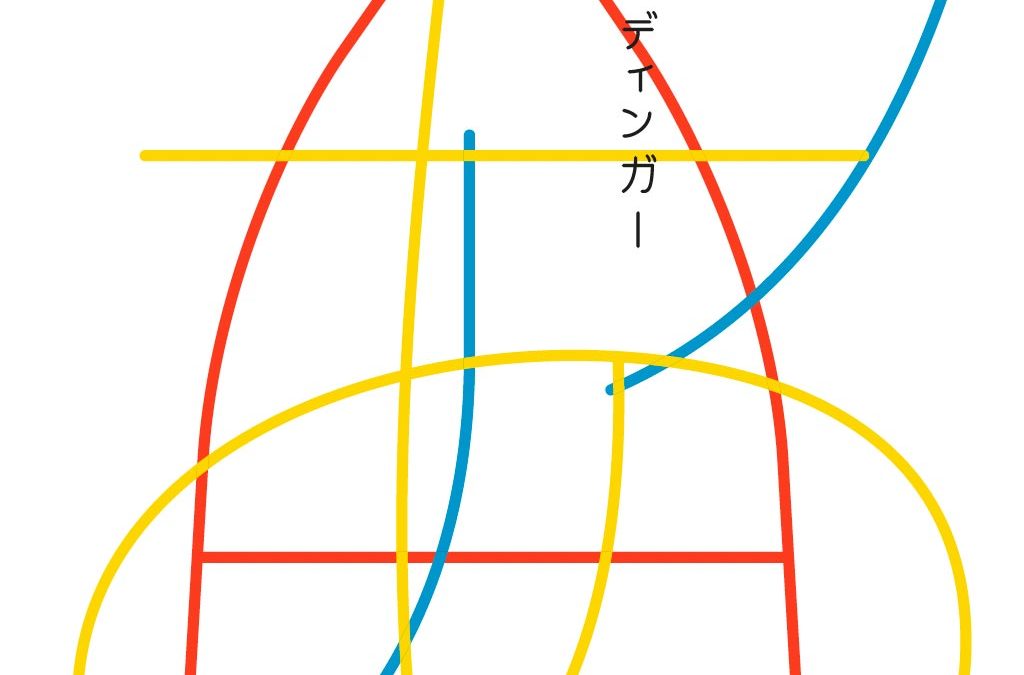Juin 9, 2022
L’exposition « Small is beautiful : Tiny Architecture, décroissance et environnement » propose une immersion dans le monde de la micro-architecture et s’attachera à rendre compte des différentes facettes de ce phénomène qui rencontre un succès croissant, tant auprès du public que pour de nombreux professionnels (architectes, designers, constructeurs…).
Cabane, caravane, yourte, hôtel capsule, containers, micro-appartements modulables … le micro-habitat est un champs protéïforme, il s’entend à la fois comme une réponse à la problématique de la pénurie de logements. Il constitue également un refuge face à l’aliénation urbaine, sous la forme de retraites mobiles miniatures, à l’écart des villes et proposant à l’Homme de renouer avec la Nature.
En combinant un ensemble de documents d’archives, de plans et de maquettes, l’exposition retracera les origines du mouvement tiny house en s’appuyant sur des figures majeures comme Henry David Thoreau (Walden, La vie dans les bois, 1854), Buckminster Fuller (Maison Dymaxion, 1930) ou encore Le Corbusier (Cabanon à Roquebrune-Cap-Martin, 1951).
Une attention toute particulière sera portée aux tiny houses contemporaines, souvent réalisées artisanalement par des passionnés, en présentant notamment des acteurs locaux de ce type de construction. Afin de dresser un panorama complet du micro-habitat, « Small is beautiful : Tiny Architecture, décroissance et environnement » traitera également d’une problématique toujours actuelle : le mal-logement.
Capsules d’habitation chez les Métabolistes japonais (Tour de capsule Nakagin, 1972) ou réponses d’urgence en milieu urbain (OPod Tube House, 2018), l’exposition explorera une sélection de propositions se donnant pour objectif de répondre à ces questions d’actualité.
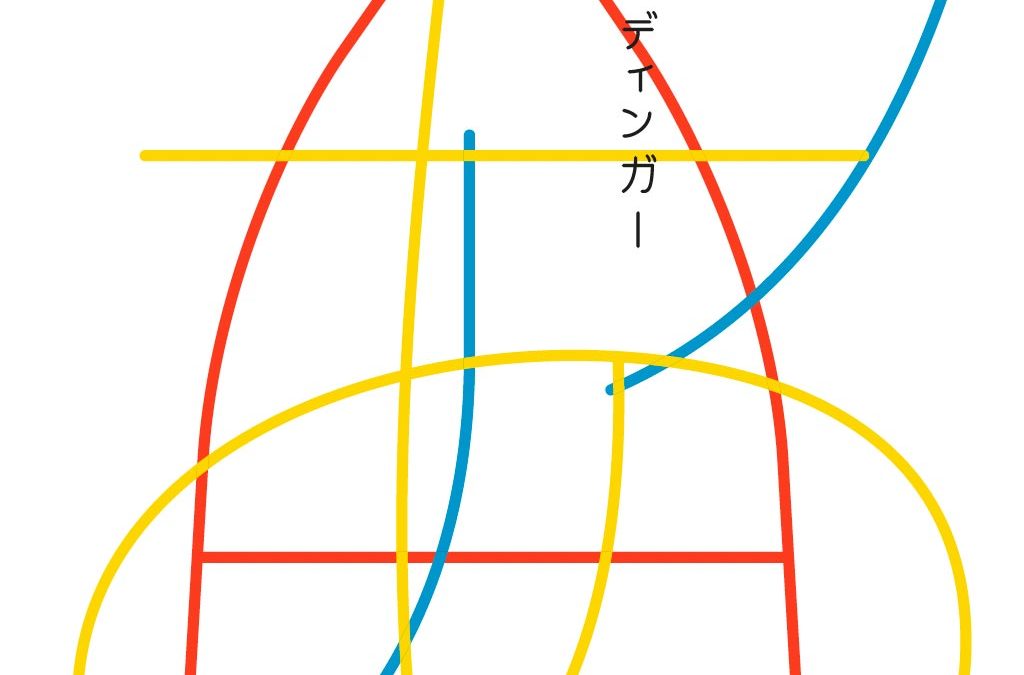
Juin 1, 2022
Langue et écriture font partie des éléments les plus distinctifs de chaque culture. Leurs transformations, développements et adaptations racontent nos origines et notre héritage historique. Chaque alphabet a son système et son répertoire formel propre.
De toutes les écritures, le japonais est une des plus complexes et, au premier abord, des plus énigmatiques.
Il n’intègre pas moins de quatre scripts distinctifs. Les kanji, hiragana, katakana et du latin. Il s’écrit en vertical, de droite à gauche ou en horizontal, de gauche à droite.
Avec les kanji qui viennent de Chine, le japonais intègre dans son système des signes de la plus ancienne écriture, vieille de 4000 ans, toujours en utilisation et en permanente extension. Chaque année des nouveaux kanji sont créés. Les katakana sont utilisés pour des mots, noms et expressions qui sont extérieurs à la culture japonaise, comme c’est de plus en plus le cas avec le latin. Les hiragana pour les verbes, adjectifs, noms propres… Le tout composant un système d’écriture exceptionnellement tolérant et intrigant.
Via le projet BLine japonais-latin, l’exposition entre dans l’univers de ces deux écritures, leurs répertoires formels et leur histoire pour mettre en évidence les recherches liées à la création de ce nouveau caractère.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme Suite initié par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en partenariat avec l’ADAGP.

Mai 24, 2022
L’exposition « 2020, Folle année graphique » procède de l’exercice convenu de la rétrospective en se concentrant sur le champ du graphisme.
Elle proposera un panorama mondial et protéïforme (affiche principalement mais aussi livres, fresques, pictogrammes, messages typographiés, animations…) autour de six grandes thématiques :
– l’impact de la pandémie sur notre champ visuel et notre espace public,
– l’explosion du mouvement BLM dans le monde et de sa production de nouvelles icones
– les expressions graphiques qui ont soutenu des contestations politiques en différents points du globe,
– l’ex-président américain en tant que phénomène médiatique,
– les nouvelles formes des luttes féministes et de comment le monde du graphisme intègre l’enjeu écologique dans ses « logiciels », techniques et éthiques.
L’exposition cherchera à expliciter le contexte de ces « énoncés visuels », les problématiques nationales comme les résonances universelles, la référence à des iconographies familières, l’utilisation de figures rhétoriques convenues ou originales.
Comment est investie la notion de graphisme engagé à l’heure de la globalisation numérique et des réseaux sociaux ? On interrogera des graphistes de multiples horizons sur ce que produit leur adhésion à ce qu’il énoncent / dénoncent, ce qui a motivé leur engagement, comment ils investissent leurs responsabilités sociale et ou politique. « 2020, folle année graphique » ? sans doute si l’on admet que le déferlement de la crise COVID a profondément contraint les expressions sociales et politiques à se recomposer, qu’elle a généré une sorte d’archétype médiatique, un emballement doublement viral emmené par des réseaux sociaux omniprésents, et probablement une nouvelle étape dans la mondialisation de la fabrique des images, impactant l’ensemble des sujets et des formes …

Mai 20, 2022
Art et architecture : un dialogue ininterrompu, une interpellation mutuelle qui n’a cessé de produire des formes hybrides… Pour cette exposition exceptionnelle, le centre d’art La Fenêtre et la galerie Samira Cambie s’associent pour présenter une sélection d’œuvres (encres, huiles, collages, …) qui illustrent la place de la ville, de l’urbain et des constructions dans les recherches plastiques et conceptuelles des artistes contemporains, pour autant de visions de l’architecture, de la ville, ou d’allégories de ceux – hommes et bêtes – qui la traversent.
Diplômée de l’École Nationale d’Architecture de Montpellier, Clara Bryon est inspirée par les architectes Tadao Ando et Louis Khan, et développe un travail sur l’architecture mêlant lumière, matière et rapport au corps, cherchant à développer un équilibre entre force et délicatesse. A l’École des beaux-arts de Paris dans l’atelier de Jean-Michel Alberola, Mathieu Weiler commence une série sur les autoroutes et le cinématographe. Dans des compositions à l’encre, il révèle le paysage urbain et donne à voir autrement des objets, des fragments et des traces d’une expérience de la ville, tout en investissant l’enjeu de l’échelle et du cadre. Les paysages de Thomas Verny sont tout autant naturels qu’urbains et, de Sète à Palavas, de Montpellier à La Grande-Motte, il peint la ville dans une succession de motifs et de formes. Thomas Verny propose « une autre vision du monde, le réinterprète en offrant des chemins nouveaux et des passerelles sur le plan de la technique, des formats et de la configuration spatiale de son imaginaire ».
Artistes présentés :Pierre Bendine-Boucar, Clara Bryon, Claude Buraglio, Pierre Buraglio, Julien Descossy, Quim Domene, Jean-Christophe Donnadieu, Tarik Essalhi, Jérémy Gabin, Curro Gonzales, Philippe Perrin, Stéphane Pencréach, Florence Obrecht et Axel Pahlavi, Yves Reynier, Anne Slacik, Guillaume Toumanian, Thomas Verny , Mathieu Weiler, Kenneth Yeung